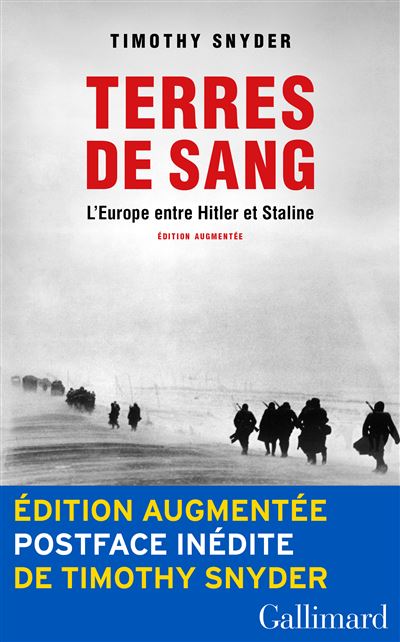La révolution russe de 1917 et ses répercussions en Allemagne
La Révolution d’Octobre 1917, menée en Russie par Lénine et les bolcheviks (ou bolchéviques), a débouché sur la création d’un État communiste, après une sanglante guerre civile. Dans l’objectif de partager avec le monde leurs conceptions et idées de la révolution et de la société, l’internationale communiste est ensuite créée. Les répercutions sur l’Europe et plus particulièrement en Allemagne sont profondes. Tantôt elles soulèvent l’espoir d’une vie meilleure, tantôt elles inquiètent et renforcent aussi les mouvements nationalistes et d’extrême droite. En l’associant à l’antisémitisme, Hitler promettra bientôt de défendre le peuple allemand de la « peste rouge » et du « complot judéo-bolchévique ».
La Révolution d’Octobre
Pendant la Première Guerre mondiale, l’enchainement des succès militaires de l’Allemagne sur le front de l’est, provoque la chute du gouvernement du tsar Nicolas II. Rongée par la guerre et mal préparée, la Russie est au bord de la famine. Chaos et désespoir règnent partout, alors que les soldats à déserter l’armée sont de plus en plus nombreux. De manière générale, le peuple russe se montre désormais hostile à la guerre et à son gouvernement.
La « terreur rouge » imposée par Lénine
En Russie, le seul parti politique à bénéficier de cette situation est le Parti bolchévique. Depuis le début, il était le seul à s’opposer à la guerre. Dirigé par un extrémiste du nom de Lénine, celui-ci avait néanmoins affirmé qu’une défaite militaire de son pays, serait le moyen le plus efficace et le plus rapide de provoquer une révolution. Vraisemblablement à l’automne 1917, le moment était venu. Lénine organise un coup d’État d’une extrême rapidité et qui – dans l’immédiat – ne rencontre que peu de résistance.
L’arrivée au pouvoir des Bolchéviques de Lénine
Lorsque les adversaires des bolchéviques tentent finalement de reprendre le pouvoir, la situation dégénère. Le nouveau régime ne tarde pas à riposter. L’ensemble des partis politiques de Russie est supprimé, marquant ainsi le début de la dictature de Lénine. Pour assurer l’emprise de son pouvoir, la création de l’Armée rouge devient un outil terriblement efficace. Dirigée par Léon Trotski, celle-ci se lance dans une abominable guerre civile contre les « Blancs », voulant rétablir le régime tsariste. Nicolas II est alors assassiné par les forces bolchéviques, avec sa femme et ses cinq enfants.
Dans ce même temps, la Tchéka (police politique du parti) s’attèle à une sanglante répression. Tous ceux qui se dressent face au nouveau régime – qu’ils soient de gauche, du centre, ou de droite – sont arrêtés, torturés, tantôt exécutés ou jetés dans des camps d’internement.
Le traité de Brest-Litovsk
Pour autant, la révolution d’Octobre n’empêche pas la guerre de se poursuivre. Or, Lénine et les bolchéviques savent que celle-ci doit se terminer, s’ils veulent consolider leur nouveau pouvoir. Dès le début de l’année 1918, un traité de paix est rapidement négocié. Signé à Brest-Litovsk, ce dernier livre un très vaste territoire à l’Allemagne qui comprend la Pologne, l’Ukraine, la Biélorussie et les pays Baltes.
En signant ce traité, Lénine est en réalité convaincu que l’Empire allemand est sur le point de s’effondrer, et que sa défaite sur le front de l’ouest n’est qu’une brève question de temps. Peut-être pourrait-il alors récupérer ces territoires perdus.
Sur ce coup, Lénine a vu juste. A l’automne 1918, malgré les renforts des soldats de l’est déployés à l’ouest, l’armée allemande est incapable de poursuivre la guerre. L’Empire allemand perd la Première Guerre mondiale et le traité de Brest-Litovsk est annulé par les traités de paix qui en découlent.
Ainsi, les Allemands doivent se retirer de leurs nouvelles régions, sans y avoir subi le moindre revers militaire. Plutôt que de rendre la totalité des territoires à la Russie, c’est la Pologne qui est créée, selon le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Néanmoins et au-delà des aspirations nationales anciennes, la Pologne doit aussi servir « d’État Tampon » entre les deux grandes puissances que sont l’Allemagne et la Russie.
L’édification d’un état et d’une société communiste
Presque inévitablement en Russie, le régime imposé par Lénine finit par triompher. Dès lors et tout en restant fidèle à ses ambitions, il entreprend la fondation d’un État et d’une société communiste. Celle-ci devait passer par la socialisation (au sens marxiste) de l’économie.
En théorie, elle devait assurer la propriété collective des biens et la confiscation des richesses. En même temps, l’abolition de la religion devait permettre l’émergence d’une conscience socialiste et laïque. Toutes ces conditions réunies devaient alors permettre la création d’une société sans classes, ni économique, ni politique, ni sociale.
La création de l’internationale communiste (Komintern)
Malgré son retrait de la guerre, Lénine pense encore que la révolution russe n’a que peu de chance de survivre, dans le cas où celle-ci ne serait pas suivie dans d’autres pays. Il espère que son voisin allemand lui emboite le pas. Mais la création de la Pologne le fait renoncer à espérer. Tout du moins dans l’immédiat et pour ce cas précis.
Dans l’objectif de partager leurs idées et leur conception de la révolution au reste du monde, les bolchéviques se lancent dans la création d’une internationale communiste : le Komintern.
En novembre 1918, la révolution allemande s’est effectivement inspirée de la révolution d’Octobre. En revanche, celle-ci n’aboutit pas à un régime communiste mais à une république ; celle de Weimar. Il n’empêche que ce partage des idées a bien touché une partie des classes européennes et allemandes.
Les conséquences en Europe et en Allemagne
En Europe de l’ouest comme en Europe centrale, l’ensemble des mesures imposées par Staline sèment généralement la peur. Les discours radicaux du communisme effarent. Les classes supérieures comme moyennes observent leurs semblables perdre leurs biens ou disparaitre dans les camps. Pour d’autres cependant, le communisme fait naître l’espoir d’un monde meilleur. Ainsi, les premiers partis communistes ouvrent leurs portes, en-dehors des frontières russes.
La fondation du Parti communiste allemand (KPD)
En Allemagne, un petit groupe issu des sociaux-démocrates, dirigé par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, se détache du traditionnel et puissant parti de gauche allemand, pour fonder le Parti communiste. Cette nouvelle inquiète fortement les membres du Parti social-démocrate. D’aucun craignent de subir les mêmes violences que leurs anciens homologues russes. Dès lors, les premiers boucliers se lèvent.
Selon eux, tout doit être fait et envisagé pour empêcher les communistes d’accéder au pouvoir. Pour leur faire obstacle, à l’évidence guidés par la peur, certains envisagent l’usage de la violence et même la suppression des libertés civiles, s’il le faut. Au centre et à droite bien sûr, les craintes sont les mêmes. En revanche, elles ne sont pas partagées avec les sociaux-démocrates pour la simple raison qu’aucune distinction n’est faite entre les deux partis. Le Parti communiste et le Parti social-démocrate ne seraient alors que deux variantes issues d’un même phénomène. Les deux sont considérés comme dangereux.
Pourtant, ce n’est pas le cas. En Allemagne, les sociaux-démocrates restent partisans de la République, ce qui n’est pas le cas des communistes. Suivant l’internationale communiste, ils louent le modèle soviétique et suivent les instructions transmises par Moscou. Il acceptera cependant le jeu républicain. À l’occasion des élections législatives de 1932, le KPD obtiendra 16,9% des voix.
La peur du bolchévisme et ses conséquences à long terme
La révolution bolchévique suscite l’espoir chez une partie – grandissante – de la classe populaire allemande. À l’opposé, au sein des élites et de la bourgeoisie, elle éveille des craintes, elles aussi grandissantes.
Dans une République de Weimar instable, marquée par de nombreux et lourds traumatismes (fusillades, assassinats, émeutes, massacres…), le « péril rouge » devient un argument majeur pour justifier et mobiliser une répression contre les mouvements de gauche, par les forces conservatrices. Pendant que le Parti communiste cherche à importer le modèle soviétique en Allemagne, les ligues et groupes paramilitaires nationalistes se renforcent.
A lire aussi → Comment Hitler est-il arrivé au pouvoir ?
La montée du nazisme en Allemagne
Parmi tant d’autres, la peur du communisme joue un rôle dans la montée du Parti nazi. Avec Hitler, l’anticommunisme devient un outil de propagande qui lui permet d’obtenir les soutiens d’une partie de la population allemande, mais aussi de certains riches et puissants industriels et à terme, de l’armée. En l’associant à un antisémitisme décomplexé, les nazis promettent de protéger la nation du « chaos rouge » et des « judéo-bolchéviques », qui comploteraient contre l’Allemagne.
Sur le même sujet…
Les conséquences de la défaite de l’Allemagne dans la Première Guerre mondiale
Les conséquences de la défaite La défaite de l'Allemagne à l'issue de la Première Guerre mondiale, marque un tournant majeur dans son Histoire. Ses conséquences, marquées par l'émergence de crises économiques, combinées à des sentiments d'humiliation, d'injustice...
Histoire de l’antisémitisme en Allemagne : origine et évolutions avant l’arrivée des nazis
À ses premières origines, l'antisémitisme est une histoire européenne et chrétienne. En revanche, c'est en Allemagne qu'il prend la tournure la plus tragique.
La Ligue pangermaniste
La Ligue pangermaniste est une association nationaliste allemande, fondée en 1894. Après la Grande Guerre, certaines de ses idées et ambitions seront reprises par les nazis.
L’Allemagne avant la Première Guerre mondiale
En 1914, l’Allemagne est à l’apogée de sa révolution industrielle. Certainement en avance sur son temps, elle est l’une des premières puissances économiques et industrielles mondiales. Pourtant, le vent de modernité qui souffle sur l’Allemagne est aussi à l’origine de tensions entre la classe conservatrice et la classe ouvrière en plein expansion.