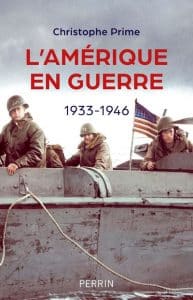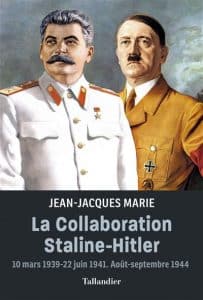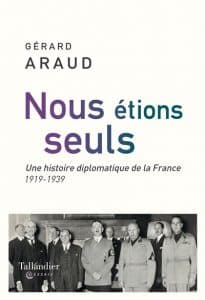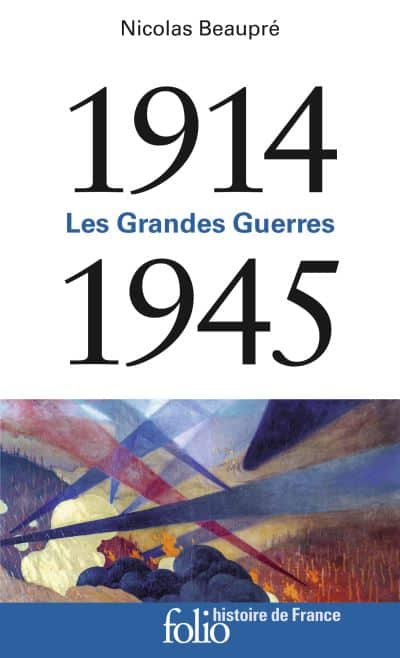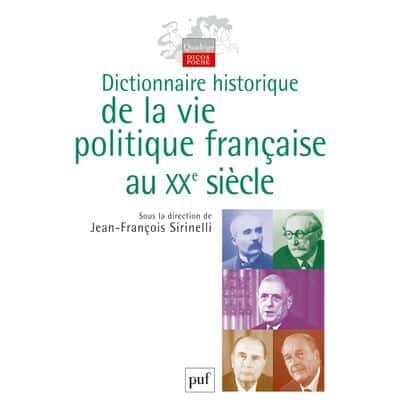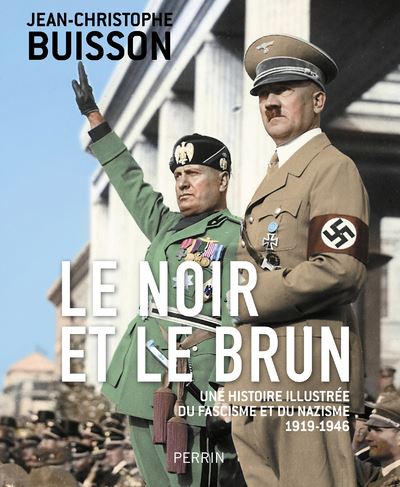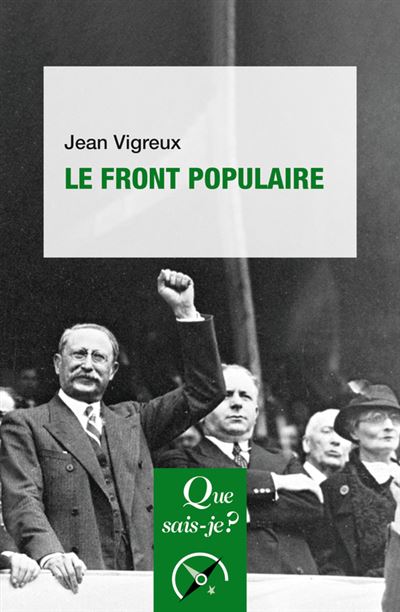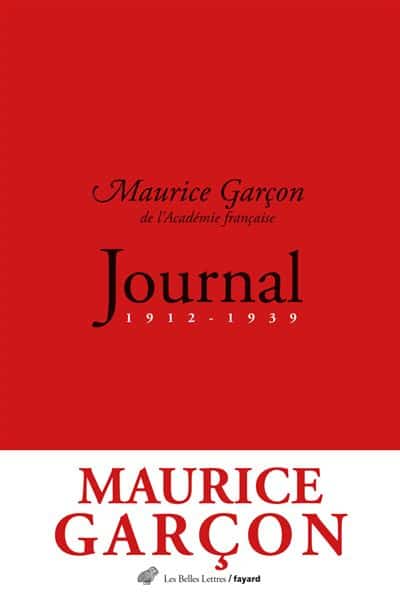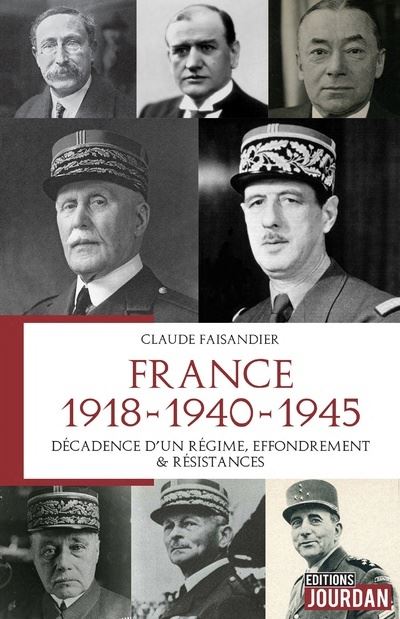Qu’est-ce que l’émeute du 6 février 1934 ?
La manifestation du 6 février 1934 est une contestation antiparlementaire, orchestrée par les principales ligues d’extrême droite. Dégénérant en émeute, la police y ouvre le feu sur les manifestants. La République française vacille. Qualifiée de « coup de force fasciste » par certains, elle est aussi à l’origine du rassemblement des gauches, qui mènera à la victoire du Front populaire, en 1936.
Manifestation du 6 février 1934 – Des manifestants sont rassemblés sur la place de la Madeleine, à Paris – Agence de presse Meurisse – Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Contexte politique de la manifestation du 6 février 1934
La manifestation du 6 février 1934 est à bien des égards le fruit d’une période marquée de multiples crises et dysfonctionnements des Institutions de la Troisième République. Depuis 1932, pas moins de 5 gouvernements se sont déjà succédés. Le sentiment de « ras-le-bol » est donc déjà très partagé. Pour une partie de la population cependant, cette lassitude se traduit aussi par une défiance parlementaire. Quoi qu’il en soit, deux faits majeurs en sont la cause directe.
L’affaire Stavisky
Un mois plus tôt, le 8 janvier plus exactement, un escroc prénommé Alexandre Stavisky est retrouvé « suicidé » dans un chalet de Chamonix. L’homme en question était recherché par la police pour une vaste histoire de détournement de fonds, notamment au Crédit municipal de Bayonne. Toutefois, la thèse du suicide avancée par les enquêteurs ne parvient pas à convaincre l’opinion générale. Car dans cette histoire, plusieurs noms d’élus et de hauts responsables politiques sont impliqués dans celle que l’on appelle désormais l’affaire Stavisky.
Suicide ou meurtre ? Mystère jamais élucidé. En attendant, les journalistes du quotidien royaliste de l’Action française s’emparent du sujet, pour dénoncer les supposés « voleurs » et « assassins » qui seraient à la tête du gouvernement. Très vite, c’est finalement la presse entière qui s’empare de ce sujet qui – de fait – fait vendre. La grogne monte assurément et les premières manifestations antiparlementaires – orchestrées par les ligues d’extrême droite – éclatent déjà au cœur de la capitale.
A lire aussi → Qu’est-ce que l’affaire Stavisky ?
Le renvoi de Jean Chiappe, préfet de police de Paris
Au-delà des nombreux articles dans la presse et des manifestations parisiennes, l’affaire Stavisky provoque déjà un bouleversement à la tête de l’État. Face à la pression populaire grandissante, le gouvernement présidé par Camille Chautemps démissionne le 27 janvier. Pour le remplacer, le Président de la République, Albert Lebrun, nomme Édouard Daladier.
Energétique et droit de réputation, le nouveau chef du gouvernement annonce aussitôt sa ferme intention d’élucider l’affaire Stavisky. C’est dans ce contexte qu’il apprend qu’un certain Jean Chiappe – et c’est avéré – a été responsable de négligences coupables, à propos des agissements de l’escroc. Or, Jean Chiappe n’est pas n’importe qui, il est le préfet de police de Paris.
Déterminé, Daladier limoge le préfet. En réalité, ce dernier se voit proposer une mutation au Maroc, mais il la refuse. Bref, Jean Chiappe écarté et voilà que la colère monte encore d’un cran, surtout au sein des ligues, pour qui il devient un « martyr ».
Jugé trop proche de ces dernières, les Socialistes avaient déjà sous peu demandé sa démission. En effet, le 22 janvier précédent, il était constaté que les policiers faisaient preuve d’une grande fermeté à l’égard d’une manifestation de fonctionnaires. Ce qui – parallèlement – n’étaient pas aussi clairement le cas lors des manifestations antiparlementaires.
Dans son livre dédié à l’histoire française des deux guerres, Nicolas Beaupré dresse le portrait de Jean Chiappe : homme d’influence ayant de nombreuses sympathies politiques à l’extrême droite, il est par ailleurs le gendre de Horace de Carbuccia, dirigeant de l’hebdomadaire Gringoire, et proche de Maurice Pujot, directeur de l’Action française.
L’organisation de la manifestation
Dans la continuité de ces événements, les ligues finissent par en appeler leurs adhérents à une grande manifestation. Celle-ci doit avoir lieu le 6 février, jour de présentation et d’investiture du gouvernement Daladier, au Parlement.
Les appels à manifester
Très rapidement cependant, les appels à manifester se suivent et s’enchainent de tous bords. Ainsi, l’Union National des Combattants (UNC), la Fédération des contribuables et encore bien d’autres organisations, cochent la case du 6 février. Au matin même du « grand jour », l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), réputée proches des communistes, appelle à son tour à former son propre cortège. Également, les conseillers municipaux de la ville de Paris, majoritairement de droite, annoncent leur présence, tout comme certains députés.
[L’ARAC] entend protester de la façon la plus énergique contre le régime du profit et du scandale en même temps que contre son mandataire le Gouvernement de M. Daladier, auteur de la révision des pensions. […]
Les objectifs des organisateurs
Ces nombreux appels à la manifestation, provenant d’organisations aussi différentes que parfois même opposées, engendrent inévitablement entre eux de profonds désaccords de fond. En revanche, il paraît juste de dire que tous se retrouvent dans la détestation du Parlement actuellement en place et dans la volonté d’empêcher la constitution du prochain gouvernement de Daladier.
A l’occasion de ce 6 février 1934 et toujours selon Nicolas Beaupré, la ligue des Croix-de-Feu entend ainsi mettre fin aux « abjectes combinaisons politiques » en imposant un gouvernement de « bons Français ». Si l’on s’en tient à sa déclaration officielle, l’ARAC entend notamment « protester […] contre le gouvernement de M. Daladier, auteur de la révision des pensions [de guerre] ». Dans son dictionnaire de la Troisième République, Jean-François Sirinelli affirme que l’UNC se fixe quant à elle pour but de déposer une pétition à l’Élysée, demandant le départ de Daladier.
De part leur nature, les ambitions des ligues d’extrême droite sont en revanche bien différentes. Si les jeunesses patriotes entendent « seulement » faire tomber le gouvernement pour permettre à la droite de revenir au pouvoir, l’Action française elle, espère bien le faire tomber afin de restaurer la monarchie. Bien que ses troupes soient plus réduites, la Solidarité française espère elle aussi renverser le régime.
A lire aussi → Qu’est-ce que les ligues d’extrême droite ?
Quand la manifestation antiparlementaire tourne à l’émeute
Du côté des forces de l’ordre, la manifestation à venir s’annonce bien délicate à encadrer. En raison des différentes natures des organisations et de leurs objectifs divers, plusieurs points de rassemblements sont indépendamment prévus. De plus, ceux-là se situent aussi bien sur la rive droite comme sur la rive gauche de la Seine. Ainsi, les rassemblements se comptent au nombre de 6 et les cortèges prévus au nombre de 5. Affiches, tracts, journaux appellent aussi les Parisiens à se rassembler devant la Chambre, sur les boulevards ou encore à la Concorde…

Manifestation du 6 février 1934 – Des manifestants arrêtent un bus au niveau de la place de la Madeleine, à Paris – Agence de presse Meurisse – Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Début de la manifestation et des affrontements avec les forces de l’ordre
La manifestation débute en fin d’après-midi, aux alentours de 17 heures. Alors que la nuit tombe progressivement, les esprits s’échauffent. À la lueur et à la chaleur d’un bus incendié, le climat devient vite palpable. Barrant l’accès du pont de la Concorde afin de protéger l’un des accès au Parlais Bourbon (lieu où se tient le Parlement), les policiers sont rapidement la cible de premiers accrochages. C’est le début des affrontements.
La violence est aussi bien physique que verbale : « A la chambre ! A la chambre ! Morts aux vaches ! A bas Daladier ! » scandent les manifestants. La clameur monte, la foule devient d’un seul coup plus dense et plus houleuse encore. Les premiers pavés sont arrachés et jetés en direction des gardes mobiles.
La police ouvre le feu
Si le plus clair des manifestations se déroulent dans une atmosphère très délictuelle, les plus violents affrontements ont lieu au niveau de la Concorde, là où sont concentrées les ligues. Face aux cavaliers de la police qui s’apprêtent à charger, des billes sont lâchées. Les chevaux se cabrent, s’écroulent puis se débattent. Sur le bout de leurs cannes, certains assaillants y ont accroché des lames de rasoir pour entamer leurs jarrets. Entre les agents à pied et les émeutiers, les échanges de coups de matraques et de barres de fer sont vifs.
Le clairon de la Garde républicaine sonne : « Obéissance à la loi ! On va faire usage de la force. Que les bons citoyens se retirent ». Mais la foule compacte fonce vers le pont, forçant les chevaux à reculer.
Sur le point d’être débordés et se jugeant en position de légitime défense, les policiers dégainent leurs armes. Il est environ 19h30 quand les premiers coups de feu éclatent.
Bilan de la nuit du 6 février 1934
Alors que sont comptés les premiers morts et les très nombreux blessés, c’est désormais une certitude : la République vacille. Plus ou moins au même moment, un peu plus de 2000 membres de la ligue des Croix-de-Feu ont finalement la possibilité de s’emparer du Palais Bourbon. Retenus par leur chef, le colonel de La Rocque, ils ne commettent pas le coup d’Etat tant espéré par l’Action française et d’autres ligues.
Au niveau de la Concorde et pendant un bref moment, l’arrivée d’anciens combattants – qui étaient jusque-là rassemblés au rond-point des Champs-Elysées – permet une brève accalmie. Le plus gros de la manifestation se déporte sur les grands boulevards. Mais à partir de 22 heures, le barrage policier est une nouvelle fois attaqué. A plusieurs reprises, il n’est pas loin d’être submergé.
Jusqu’à 2h30 du matin, les charges, attaques et coups de feu se succèdent et s’échangent de part et d’autre. Plusieurs véhicules sont incendiés, des arbres abattus et bon nombre de bancs et pavés sont arrachés.
Selon une commission d’enquête parlementaire, avancée par Nicolas Beaupré dans son ouvrage, le bilan humain de cette nuit du 6 février 1934 monte à 14 morts et 657 blessés du côté des manifestants. Plus tard, deux autres décèderont des suites de leurs blessures. Les troupes d’émeutiers chez qui il est dénombré le plus de victimes sont celles de trois ligues d’extrême droite : Action française, Solidarité française et Jeunesses patriotes. Du côté des forces de l’ordre, il est compté un mort et plus de 1 600 blessés.
Après les événements du 6 février
Au lendemain de l’émeute naissent déjà des interprétations aussi différentes qu’opposées. Pour la gauche, il s’agit incontestablement d’un « coup de force fasciste » ayant échoué. Pour la droite et l’extrême droite, d’un massacre d’honnêtes citoyens par un « pouvoir définitivement corrompu ».
Nouveau changement de gouvernement
Pendant que les manifestants battaient le pavé parisien, Édouard Daladier obtenait la confiance du Parlement par 360 voix, contre 220. Si l’objectif initial de la manifestation était de provoquer son départ, force est de constater qu’il se solde par un échec. Tout du moins, dans un premier temps.
Car le nouveau chef est déterminé à se maintenir en poste et à prendre toutes les mesures fortes à l’encontre des émeutiers. Cependant, plus les événements de la nuit remontent aux oreilles des politiques et plus Daladier sent sa position devenir vulnérable. Très vite, les soutiens préalablement sollicités, issus des milieux de la justice, de l’armée et surtout de la police, se dérobent peu à peu.
Au matin du 7 février, alors que de futures manifestations sont déjà annoncées, le Président de la République, les présidents du Sénat et du Parlement, plusieurs de ses ministres et même des proches de son propre parti, lui conseillent de démissionner. Ce qu’il finit par faire. De fait, les manifestants obtiennent d’une certaine manière ce qu’ils voulaient : le départ du gouvernement. Pour la première fois dans l’histoire de la Troisième République, le pouvoir est renversé par la pression populaire.
Pour le remplacer, c’est un ancien Président de la République – à la retraite – qui est nommé : Gaston Doumergue. Investi dès le 8 février, il forme un gouvernement dominé par la droite dès le lendemain, et se fixe pour missions le retour au calme et la réforme en profondeur des Institutions de la République.
S’il parvient rapidement à obtenir un calme bien relatif, notamment grâce à la présence du maréchal Pétain, nommé ministre de la Guerre, la réforme de l’État s’avère être une toute autre épreuve. Face à cet échec à venir, il démissionnera à son tour, le 8 novembre suivant.
Comprendre l’émeute du 6 février 1934
La nuit du 6 février est-elle réellement une tentative de coup de force fasciste ? Rappelant la marche de Mussolini sur Rome ou les manifestations de rue des nazis en Allemagne, c’est en tout cas ce qu’affirme la gauche française, à cette époque. De la même manière, elle affirme aussi que les ligues d’extrême droite sont majoritairement fascistes, plus particulièrement celle des Croix-de-Feu du colonel de La Rocque.
De nombreux historiens l’affirment aujourd’hui (c’est pas exemple le cas de Jean Vigreux, dans son ouvrage dédié au Front populaire), la manifestation du 6 février est davantage une manifestation antiparlementaire, visant à déstabiliser les Institutions, certes, mais pas nécessairement à s’emparer du pouvoir pour y imposer une dictature. L’objectif premier de la manifestation consiste bel et bien à empêcher la constitution du gouvernement Daladier.
Si nous l’avions voulu, nous aurions occupé le ministère de l’Intérieur le 5 février, et le 6 février la Chambre. Nous ne l’avons pas voulu parce que nous poursuivions le rétablissement de l’ordre et non la réalisation d’un coup de force.
Analyse du 6 février 1934 par Jean-François Sirinelli
Pour mieux comprendre, reprenons l’analyse faite par Jean-François Sirinelli. Selon lui, il est important de distinguer l’action des différents groupes ou mouvements :
- Il faut mettre à part les quelques milliers de manifestants communistes, convoqués par leur association d’anciens combattants (ARAC), au rond-point des Champs-Elysées. Bien que certains se soient par la suite mêlés aux forces d’extrême droite dans les affrontements avec la police, leur manifestation consiste – selon les directives de leur mouvement – simplement à remonter l’avenue des Champs-Elysées, en direction de l’Arc de Triomphe.
- La ligue des Croix-de-Feu quant à elle, et bien qu’elle en avait la possibilité, n’entend pas s’emparer du Palais Bourbon mais plutôt à procéder à une démonstration de force. Comme elle en a finalement l’habitude avec ses formations paramilitaires. Par ailleurs, le colonel de La Rocque ordonne la dispersion de ses troupes autour de 20h45. Les autres ligues ne manqueront pas de le lui reprocher dans un futur proche.
- Pour ce qui est de l’association des anciens combattants de l’UNC, sa direction a toujours affirmé son loyalisme républicain. Lors de la manifestation et malgré les difficultés du moment, son service d’ordre parvient à tenir ses troupes. En revanche, bon nombre d’anciens combattants de l’association se mêlent effectivement par la suite aux émeutiers.
- Finalement et comme expliqué plus haut, seule la ligue de l’Action française entend véritablement renverser le pouvoir afin de restaurer la monarchie. Associés à ceux des ligues des Jeunesses patriotes et de la Solidarité française, leurs militants sont bien les « leaders » de l’émeute. Cependant, aucune de ces ligues ne se réclament du fascisme. Au mieux, elles empruntent seulement certains de ses codes.
Les contre-manifestations des 9 et 12 février et le rassemblement des gauches
Quoi qu’il en soit et comme les événements sont interprétés comme un coup de force fasciste, mettant en danger le régime républicain, la gauche se mobilise pour organiser les contre-manifestations antifascistes des 9 et 12 février suivants. Manifestations auquel participe par ailleurs Missak Manouchian, entré au Panthéon le 21 février 2024.
Si l’émeute du 6 février a révélé la fragilité ou les faiblesses des Institutions, elle a aussi été un événement catalyseur du rapprochement des gauches. Ce rapprochement mènera au Front populaire, et à sa victoire aux législatives de mai 1936.
Dans le milieu où je vis, la fusillade de mardi est un crime inexpiable, dans les milieux d’extrême gauche, elle était la solution nécessaire pour le rétablissement de l’ordre. Les communistes s’agitent. Demain, ils descendront dans la rue. Si on les fusille, ceux sur lesquels on a tiré mardi applaudiront. Quels sinistres revirements !
Sur le même thème…
L’affaire Stavisky
D'un simple "fait divers" à un véritable scandale d'État, l'affaire Stavisky n'a pas seulement fait couler beaucoup d'encre, elle a fait vaciller la République.
Les ligues d’extrême droite
Elles prônent des idées révolutionnaires, autoritaires, antiparlementaires, antisémites, anticommunistes ou xénophobes. Leur principal moyen d’expression est la violence et l’occupation des espaces publiques.
Comment Hitler est-il arrivé au pouvoir ?
A-t-il réellement été élu par le peuple allemand ?
L’entrevue de Montoire : la rencontre entre Hitler et Pétain
Au-delà de cette poignée de main, que savons-nous de cette rencontre ? Retour sur l'entrevue de Montoire.